Alors que s’ouvre le Salon du Livre, grand raout annuel du
monde des Lettres, Zone Littéraire donne la parole à un écrivain
en rupture avec le milieu français de la culture, Marc-Édouard
Nabe, dont Le Dilettante réédite cette année le premier livre,
Au Régal des vermines. En réponse à la célebration de la
francophonie, celui qui dit adorer la langue française blâme la
« conception étriquée qu’en a l’esprit français ». Il regrette le peu de considération que la France a pour les écrivains
étrangers, grande part de son panthéon personnel, et revendique depuis ses débuts la jouissance du Verbe, une transgression sociale dont « la France a toujours eu peur ».
Ce rare désir de liberté, assouvi sans réserve, est peut-être la raison du peu de cas que le « milieu littéraire » a fait de ses vingt sept livres, qui déploient tous une langue déchaînée, inventive et exaltée comme on en lit peu. Et les réticences
gênées ne se font pas attendre. Publié en 1985, Au Régal des vermines dressait déjà un procès-verbal implacable : « quand je me suis vu méticuleusement refermer toutes les portes, j’ai bien dû me rendre à l’évidence : Rimbaud est un vieillard ». Dans ce premier jet enthousiaste et vindicatif, Marc-Édouard Nabe n’aspirait qu’à deux choses : l’Art et la liberté du créateur. En plein cœur des très molles années 1980, il fustigeait l’officialisation des grands artistes disparus, le dévoiement de leurs révoltes par la culture de masse et refusait catégoriquement la doctrine imposée de « la mort de l’Art ».
Et qu’on lui parle d’art, il prétend savoir de quoi il retourne. Conçu, né et élevé dans le jazz, musique dont on ne chantera jamais assez les belles révolutions, guitariste lui même et peintre chérissant la couleur, il a choisi de vivre d’écriture pour plonger dans le réél et y ramener de la vérité. Un Idiot Dostoïevskien habité par un swing drôle et tragique, dont la carrière lancée avec fracas fut jalonnée d’incompréhension et de dénigrement dans une société française aspirant au conformisme social et culturel. Vingt ans plus tard, le constat qu’il développe dans une grande préface à la nouvelle édition du Régal est amer. Il a toujours trouvé l’amitié parmi les artistes, dont Michel Houellebecq, et les inimitiés chez les éditeurs historiques et les journalistes de masse. Des prises de position parfois radicales lui ont valu des procès, il a subi les qualificatifs humiliants, il perd aujourd’hui son éditeur, Le Rocher. Alors qu’on sorte un magnétophone, il sort le sien, par souci de la preuve. Entretien avec un écrivain volubile, activiste virevoltant d’une seule cause : le présent et sa joie !
Propos recueillis par Marc Delaunay et Laurent Simon
Le Salon du livre prend des airs de sommet de la
francophonie. Il y a déjà le patronage de Chirac, il ne manque
que les chefs d’état africains. Ca vous agace ?
Non. Le salon du livre ce n’est que de la Culture, c’est tout à fait
la place d'un président de la République, mais ce n’est pas la
mienne. Je n’ai pas à être au milieu des gens de lettres, à mon
tour de les boycotter ! La dernière fois que j’y suis allé, on m’a
jeté une coupe de champagne à la figure. C'a été admirable et
symbolique : en me rebaptisant ainsi, sainte Josyane Savigneau
[ancienne rédactrice en chef du Monde des Livres, ndlr] voulait
me dire « vous n’avez rien à faire ici ». Je l’ai entendu autrement
: « vous méritez mieux que ce petit monde là »… Ce n’est pas
parce que j’écris des livres que je dois fréquenter le milieu
littéraire. C’est une tentation à laquelle succombent la plupart de
mes collègues. Même les plus "rebelles". Finalement, c’est
comme quand on a des enfants : il y a une espèce de
communauté de parents d’élèves qui se met en place de
manière tout à fait insidieuse. Ca commence le premier jour
d’école, il se crée une connivence, puis une fréquentation, voire
une amitié. C’est à ce moment là que j’ai pris les jambes à mon
cou. C’est le même principe avec le milieu, tout aussi infantile,
des Lettres. Les écrivains, parce qu'ils publient, se croient
obligés de fréquenter d'autres écrivains, et aussi des éditeurs et
des journalistes. Et en plus c'est intéressé, car ils misent sur
les journaux dans lesquels ils pigent pour qu'ils leur fassent
des articles quand ils sortiront leurs navets. Voilà pourquoi
quelqu'un qui ne n'entretient pas son réseau entre deux romans
peut être sûr que la presse et les médias passeront les sien à
l'as.
Faut il aller chercher la littérature dans la francophonie ou
carrément à l’étranger ?
Personnellement, mes influences sont très peu françaises.
Même s’il y a quelques écrivains de " l’Hexagone " parmi elles,
c’est une garde qui cache toute une armée. Derrière Léon Bloy,
Suares ou Celine, il y a Strindberg, DH Lawrence, les frères
Powys, Thomas Wolfe, Malaparte, Gogol, Gadda, Lezama
Lima… des auteurs complètement négligés. Sans parler de
Kafka ou Dostoïevski que les "lettrés" français font semblant
d'apprécier pour de mauvaises raisons. Ce sont eux mes vrais
maîtres dans l’écriture, dans la façon de concevoir une oeuvre.
Ils ont exploré d’autres terres beaucoup plus intéressantes que
celle de la culture frenchy. J’adore la langue française mais je
ne veux pas appartenir à la culture française. L’idéologie
française me débecte.
Qu’est ce que cette fameuse idéologie française ?
L’esprit français est horrible, on s’en est toujours plaint. Il a une
conception tellement étriquée de la langue. Nous autres
écrivains français lyriques d’inspiration étrangère, avons
toujours souffert des idées, de l’idéologie, de la politique -au
sens le plus restreint- qui encombrent et empêchent d’atteindre
le Verbe ! La France est un pays qui est contre le Verbe. Voilà,
c’est tout, et elle adore le dire dans un blabla explicatif
détestable !
Ca se complique pour les écrivains, dans ce cas . La culture
est de leur côté mais le Verbe les fuit. Quel est leur rôle,
finalement ?
Un écrivain n’est pas un acteur, il ne joue donc pas. Même le
rôle du refoulé que je suis pourtant, je ne veux pas l’endosser.
Moi j'écris la pièce, je ne joue pas dedans. Je suis un inventeur
de formes, un transgresseur de celles qui existent. Mes
poèmes, mes romans, mes aphorismes n’en sont pas. Je ne
veux pas de romans comme les lecteurs traditionnels du roman
l’entendent. Voilà pourquoi les miens ne sont pas encore
compris. Il faut casser tous les clichés qu’ils soient classiques
ou avant-gardiste. Il y a un dogme de la narration pour les
journalistes ou les amateurs de littérature auquel on ne peut
opposer aucun blasphème. Je ne suis ni un romancier pompier
qui n'a rien à dire, ni un avant-gardiste qui cache qu’il ne sait
pas raconter une histoire.
En vingt ans de vie éditoriale, depuis la sortie d’Au régal
des vermines jusqu’à sa réédition, peut on dire que vous
avez réussi dans la subversion ?
« De défaite en défaite jusqu’à la victoire », disait Mao Tse
toung. On pourrait également citer Napoléon : « Quand on
regarde une victoire dans le détail, on en voit qu'une succession
de défaites » ! Etre un écrivain subversif -comme vous dites-
était un rêve d’enfant. Au Régal des vermines était le livre de
mes vingt ans et j’ai mis cinq ans à trouver un éditeur : Bernard
Barrault. Ca n’a pas été facile.
Est-ce que vous aviez envisagé ces difficultés au départ
?
Oui, inconsciemment, mais il faut un certain niveau
d’inconscience pour pouvoir le faire. Comme un sportif qui saute
pour la première fois en parachute. Les préoccupations
concrètes de rendre réalisable l’entreprise prennent le pas sur
la peur ou le fantasme.
Y avait il une volonté de bousculer la société ?
C’est ce qu'a toujours voulu faire tout artiste. Un écrivain ne doit
pas, à chaque phrase, essayer de bourrer ses contemporains
de somnifères mais au contraire de les réveiller. On peut le faire
avec des baisers, d’autres leur foutent des baffes. Je ne trouve
pas la société assez belle pour la réveiller à coups de baisers…
Ayant été refoulé et l’étant toujours, ce serait du «
schpountzisme » de croire que j’ai eu une influence réelle sur la
société d’aujourd’hui !
Un espace n’est il en train de se créer à la suite de
Houellebecq ou de Dantec. La parole allouée à l’écrivain n’est
elle pas plus libre maintenant ?
La réponse suprême opposée à l’écrit, c'est le silence. La mise
à l’écart, la réduction de la parole de l’écrivain est la seule
preuve que celui-là est libre. En poussant un peu, on pourrait
dire, et ça m'intéresse de plus en plus, que celui qui arrive à
s'exprimer n'est pas libre de le faire… On essaie de transformer
des petits scandaleux en subversifs, qui, finalement collent très
bien à leur époque. Ils sont rangés plutôt que dérangeants.
Demandez-leur plutôt à eux, on vient toujours me voir pour parler
d'eux, mais eux se gardent bien de parler de moi, ils se
comportent à mon égard comme les officiels qui soi-disant les
accusent de tous les maux. Quant à l’espace de liberté dont
vous parlez, mon exemple montre que cela est faux. Au moment
où l’un est accepté et devient une institution littéraire et l’autre
retrouve un éditeur pour son journal intime, moi c’est le
contraire: je n’ai plus d’éditeur, on me coupe les vivres et on
m’empêcherait de publier mon propre journal intime si je n'avais
pas eu la bonne idée prémonitoire de l'interrompre il y a
quelques années… Je suis donc obligé de rééditer mon
premier livre, épuisé depuis vingt ans, qui n’avait pas été lu par
toute une génération. Le seul critère du dérangement est la
mise sous silence, à toute époque. On vous refoule. La petite
médiatisation qui a eu lieu autour de mon livre n’est là que pour
éviter que je me plaigne d’être ostracisé. Une petite émission de
télé, une petite émission de radio, un petit article, c'est toujours
utile pour me discréditer quand je remarque qu’on ne parle pas
assez de mes livres pour qu'ils se vendent, et donc pour que je
puisse en écrire d'autres…
C’est une conspiration ?
Non, je l’ai déjà dit: je ne crois pas à l’existence d’un complot.
C'est plutôt une mode à l'envers: c'est dans l'air du temps de me
débrancher. Gogol se déplaçait toujours avec une valise remplie
des articles négatifs écrits sur lui. Cela lui permettait de lutter
contre la paranoïa et d’exorciser la douleur de traîner ça dans sa
tête tout le temps. C’était sa valise de merdes, sa poubelle avec
qui il sortait toujours. Il la mettait sous les tables et pouvait
penser à autre choses. C’était une manière de se dire qu’il ne
rêvait pas cette hostilité et en même temps de s’en libérer.
Y-a-t-il toujours une mainmise soixante-huitarde sur la
culture ?
Je crois avoir été le premier, déjà en 1985 à la dénoncer. Il fallait
dire non à cette fausse liberté, à cette fausse révolte, cette
fausse subversion qui était la trahison des idéaux libertaires
des années 60 par des bourgeois " de gauche " désireux de
remplacer ceux " de droite ".
La France est elle gavée d’Art et de littérature, au point d’en
être blasée et de la négliger ?
Non, le vrai problème est la carence d’Art. Il y a une ignorance
fondamentale de ce qu’est une oeuvre d’Art depuis une
soixantaine d’années. J’ai vécu dans l’Art depuis toujours et je
veux le défendre. A mon sens, même un militantisme de l’Art ne
serait pas suffisant. C’est crucial de lutter contre sa prétendue
mort inculquée comme une Loi depuis Marcel Duchamp.
Lui-même a d’ailleurs été mal compris : Duchamp n’était pas
contre l’Art, il était contre la « culturisation » de l’art, sa
récupération par les parasites cultureux. Il swinguait autant que
Duke Ellington, dont il était contemporain. La confusion qu’on
entretient entre la culture et l’Art, entre le beau et le joli, entre le
social et le révolutionnaire, tout cela fait qu’on n’a plus le sens
de ce qu’est une oeuvre.
Vous vous mettez en scène de façon très exhaustive dans
toute votre œuvre. Est ce pour atteindre l’ultime subjectivité ou
l’ultime objectivité ?
Je suis extrêmement objectif. Mon expérience personnelles des
artistes et celle que m’a rapporté mon père, de la bouche même
des génies du jazz qu'il a fréquentés à New York au milieu des
années 50, est que le grand art n'est qu'objectivité. Une seule
note à jouer dans telle ou telle circonstance. Miles Davis n’est
que le concrétisateur objectif d'une évidence qui se présente. Il y
a sur chaque événement une seule chose à dire, même si
certains ont peur de le faire. C’est pour cette raison que je me
sens souvent obligé de le faire puisque les autres ne s'y collent
pas. Ce n’est pas mon goût qui est en jeu. Je passe pour un
provocateur subjectif, alors que je suis un "dégageur de sens"
objectif.
Pour aller vers plus d’objectivité, la science est récemment
venue au secours du roman en France. Cette voie est elle la
bonne ?
Je ne crois pas. Moi je suis dans le présent et sa transfiguration.
C’est la définition parfaite de l’improvisation jazzistique. La
transfiguration implique la mystique de l’instant et
l’improvisation qui en découle, qui en dépend. C’est la joie de
mourir plutôt que la joie de vivre qui est présente chez la plupart
de mes collègues. Voilà pourquoi ils se réfugient dans un futur
qui est d'autant plus facile à imaginer qu’il n’arrivera pas. Ils se
tromperont et ils se trompent déjà. Je prends toujours l’exemple
de Robida [illustrateur de Jules Verne, ndlr] qui a imaginé des
vélos volants dans Paris à l'an 2000, mais pas des téléphones
portables !
Le suc de l’œuvre est donc la mystique et rien que la
mystique, pour vous.
Oui, même Marcel Duchamp, pour y revenir, était un mystique. Il
n’était pas un nihiliste mais un mystique du rien. Le ready-made
est une œuvre totalement mystique. On prend un objet et on le
sacre. On l'entoure d' une liturgie. Marcel a pris un
porte-bouteilles du BHV " au hasard" et en a fait un calice, un
tabernacle. Ceux qui suivent Duchamp en désacralisent au
contraire l’objet dénaturent sa subversion.
Houellebecq fait partie de ces grands « désacralisateurs ».
Dans votre préface, vous vous déclarez être à ses antipodes,
mais vous avez pourtant tellement de points communs…
Déjà topographiques, puisqu’on était voisins. Moi qui ai des
difficultés à gagner ma vie aujourd'hui, je crois que je vais finir
guide de cour d'immeuble ! Je vais me faire payer pour faire
visiter aux fans du Prix Interallié 2005 l’endroit où a vécu le grand
Michel !
Vous le revoyez ?
Non, mais on se parle à travers nos livres, celui-là en particulier,
Le Vingt-septième livre… C’est le seul écrivain à qui j’ai eu envie
de parler aujourd’hui sans avoir besoin de se téléphoner. Il est
intéressant de voir que l’époque a produit deux écrivains si
différents qui habitaient juste à côté. L’analyse n’avait jamais été
faite, je me suis permis de la faire.
Est-ce que vous allez continuer à écrire, est-ce que vous
avez encore envie ?
Ah oui ! Toute ma vie, j’aurais envie d’écrire. Ce n'est pas une
question d'envie, mais de possibilité éditoriale. Tant que je ne
retrouverai pas la liberté que j'avais de publier ce que j'ai à
écrire, je ne pourrais pas avancer. Il y a certaines choses qui ne
peuvent pas être dites clairement aujourd'hui, et moi je ne veux
pas accepter de les dire d'une façon plus obscure pour
m'adapter à l'édition française! Prenons comme signe que tout
ce que j'aurais à dire sur les manifestatins d'aujourd'hui, vous
même sur internet vous ne pouvez pas les mettre en ligne car
mon dégoût pour les jeunes anti- CPE et ma détestation des
vieux pro-CPE sont irrecevables. A peine si vous me laissez dire
que je suis du côté des casseurs qui sauvent l'honneur de ces
étudiants luttant pour plus de sécurité, en massacrant la
Sorbonne comme l'autre soir. Péguy aurait été fier d’eux. Je suis
obligé de remarquer que la violence qui s’exprime aujourd’hui
en France coïncide avec la réédition de mon premier livre. Au
régal des vermines devrait être dans la poche de tous les
casseurs !…
Laurent Simon
Marc-Edouard Nabe
Ed.
0 p / 0 €
ISBN:
Read more...
monde des Lettres, Zone Littéraire donne la parole à un écrivain
en rupture avec le milieu français de la culture, Marc-Édouard
Nabe, dont Le Dilettante réédite cette année le premier livre,
Au Régal des vermines. En réponse à la célebration de la
francophonie, celui qui dit adorer la langue française blâme la
« conception étriquée qu’en a l’esprit français ». Il regrette le peu de considération que la France a pour les écrivains
étrangers, grande part de son panthéon personnel, et revendique depuis ses débuts la jouissance du Verbe, une transgression sociale dont « la France a toujours eu peur ».
Ce rare désir de liberté, assouvi sans réserve, est peut-être la raison du peu de cas que le « milieu littéraire » a fait de ses vingt sept livres, qui déploient tous une langue déchaînée, inventive et exaltée comme on en lit peu. Et les réticences
gênées ne se font pas attendre. Publié en 1985, Au Régal des vermines dressait déjà un procès-verbal implacable : « quand je me suis vu méticuleusement refermer toutes les portes, j’ai bien dû me rendre à l’évidence : Rimbaud est un vieillard ». Dans ce premier jet enthousiaste et vindicatif, Marc-Édouard Nabe n’aspirait qu’à deux choses : l’Art et la liberté du créateur. En plein cœur des très molles années 1980, il fustigeait l’officialisation des grands artistes disparus, le dévoiement de leurs révoltes par la culture de masse et refusait catégoriquement la doctrine imposée de « la mort de l’Art ».
Et qu’on lui parle d’art, il prétend savoir de quoi il retourne. Conçu, né et élevé dans le jazz, musique dont on ne chantera jamais assez les belles révolutions, guitariste lui même et peintre chérissant la couleur, il a choisi de vivre d’écriture pour plonger dans le réél et y ramener de la vérité. Un Idiot Dostoïevskien habité par un swing drôle et tragique, dont la carrière lancée avec fracas fut jalonnée d’incompréhension et de dénigrement dans une société française aspirant au conformisme social et culturel. Vingt ans plus tard, le constat qu’il développe dans une grande préface à la nouvelle édition du Régal est amer. Il a toujours trouvé l’amitié parmi les artistes, dont Michel Houellebecq, et les inimitiés chez les éditeurs historiques et les journalistes de masse. Des prises de position parfois radicales lui ont valu des procès, il a subi les qualificatifs humiliants, il perd aujourd’hui son éditeur, Le Rocher. Alors qu’on sorte un magnétophone, il sort le sien, par souci de la preuve. Entretien avec un écrivain volubile, activiste virevoltant d’une seule cause : le présent et sa joie !
Propos recueillis par Marc Delaunay et Laurent Simon
Le Salon du livre prend des airs de sommet de la
francophonie. Il y a déjà le patronage de Chirac, il ne manque
que les chefs d’état africains. Ca vous agace ?
Non. Le salon du livre ce n’est que de la Culture, c’est tout à fait
la place d'un président de la République, mais ce n’est pas la
mienne. Je n’ai pas à être au milieu des gens de lettres, à mon
tour de les boycotter ! La dernière fois que j’y suis allé, on m’a
jeté une coupe de champagne à la figure. C'a été admirable et
symbolique : en me rebaptisant ainsi, sainte Josyane Savigneau
[ancienne rédactrice en chef du Monde des Livres, ndlr] voulait
me dire « vous n’avez rien à faire ici ». Je l’ai entendu autrement
: « vous méritez mieux que ce petit monde là »… Ce n’est pas
parce que j’écris des livres que je dois fréquenter le milieu
littéraire. C’est une tentation à laquelle succombent la plupart de
mes collègues. Même les plus "rebelles". Finalement, c’est
comme quand on a des enfants : il y a une espèce de
communauté de parents d’élèves qui se met en place de
manière tout à fait insidieuse. Ca commence le premier jour
d’école, il se crée une connivence, puis une fréquentation, voire
une amitié. C’est à ce moment là que j’ai pris les jambes à mon
cou. C’est le même principe avec le milieu, tout aussi infantile,
des Lettres. Les écrivains, parce qu'ils publient, se croient
obligés de fréquenter d'autres écrivains, et aussi des éditeurs et
des journalistes. Et en plus c'est intéressé, car ils misent sur
les journaux dans lesquels ils pigent pour qu'ils leur fassent
des articles quand ils sortiront leurs navets. Voilà pourquoi
quelqu'un qui ne n'entretient pas son réseau entre deux romans
peut être sûr que la presse et les médias passeront les sien à
l'as.
Faut il aller chercher la littérature dans la francophonie ou
carrément à l’étranger ?
Personnellement, mes influences sont très peu françaises.
Même s’il y a quelques écrivains de " l’Hexagone " parmi elles,
c’est une garde qui cache toute une armée. Derrière Léon Bloy,
Suares ou Celine, il y a Strindberg, DH Lawrence, les frères
Powys, Thomas Wolfe, Malaparte, Gogol, Gadda, Lezama
Lima… des auteurs complètement négligés. Sans parler de
Kafka ou Dostoïevski que les "lettrés" français font semblant
d'apprécier pour de mauvaises raisons. Ce sont eux mes vrais
maîtres dans l’écriture, dans la façon de concevoir une oeuvre.
Ils ont exploré d’autres terres beaucoup plus intéressantes que
celle de la culture frenchy. J’adore la langue française mais je
ne veux pas appartenir à la culture française. L’idéologie
française me débecte.
Qu’est ce que cette fameuse idéologie française ?
L’esprit français est horrible, on s’en est toujours plaint. Il a une
conception tellement étriquée de la langue. Nous autres
écrivains français lyriques d’inspiration étrangère, avons
toujours souffert des idées, de l’idéologie, de la politique -au
sens le plus restreint- qui encombrent et empêchent d’atteindre
le Verbe ! La France est un pays qui est contre le Verbe. Voilà,
c’est tout, et elle adore le dire dans un blabla explicatif
détestable !
Ca se complique pour les écrivains, dans ce cas . La culture
est de leur côté mais le Verbe les fuit. Quel est leur rôle,
finalement ?
Un écrivain n’est pas un acteur, il ne joue donc pas. Même le
rôle du refoulé que je suis pourtant, je ne veux pas l’endosser.
Moi j'écris la pièce, je ne joue pas dedans. Je suis un inventeur
de formes, un transgresseur de celles qui existent. Mes
poèmes, mes romans, mes aphorismes n’en sont pas. Je ne
veux pas de romans comme les lecteurs traditionnels du roman
l’entendent. Voilà pourquoi les miens ne sont pas encore
compris. Il faut casser tous les clichés qu’ils soient classiques
ou avant-gardiste. Il y a un dogme de la narration pour les
journalistes ou les amateurs de littérature auquel on ne peut
opposer aucun blasphème. Je ne suis ni un romancier pompier
qui n'a rien à dire, ni un avant-gardiste qui cache qu’il ne sait
pas raconter une histoire.
En vingt ans de vie éditoriale, depuis la sortie d’Au régal
des vermines jusqu’à sa réédition, peut on dire que vous
avez réussi dans la subversion ?
« De défaite en défaite jusqu’à la victoire », disait Mao Tse
toung. On pourrait également citer Napoléon : « Quand on
regarde une victoire dans le détail, on en voit qu'une succession
de défaites » ! Etre un écrivain subversif -comme vous dites-
était un rêve d’enfant. Au Régal des vermines était le livre de
mes vingt ans et j’ai mis cinq ans à trouver un éditeur : Bernard
Barrault. Ca n’a pas été facile.
Est-ce que vous aviez envisagé ces difficultés au départ
?
Oui, inconsciemment, mais il faut un certain niveau
d’inconscience pour pouvoir le faire. Comme un sportif qui saute
pour la première fois en parachute. Les préoccupations
concrètes de rendre réalisable l’entreprise prennent le pas sur
la peur ou le fantasme.
Y avait il une volonté de bousculer la société ?
C’est ce qu'a toujours voulu faire tout artiste. Un écrivain ne doit
pas, à chaque phrase, essayer de bourrer ses contemporains
de somnifères mais au contraire de les réveiller. On peut le faire
avec des baisers, d’autres leur foutent des baffes. Je ne trouve
pas la société assez belle pour la réveiller à coups de baisers…
Ayant été refoulé et l’étant toujours, ce serait du «
schpountzisme » de croire que j’ai eu une influence réelle sur la
société d’aujourd’hui !
Un espace n’est il en train de se créer à la suite de
Houellebecq ou de Dantec. La parole allouée à l’écrivain n’est
elle pas plus libre maintenant ?
La réponse suprême opposée à l’écrit, c'est le silence. La mise
à l’écart, la réduction de la parole de l’écrivain est la seule
preuve que celui-là est libre. En poussant un peu, on pourrait
dire, et ça m'intéresse de plus en plus, que celui qui arrive à
s'exprimer n'est pas libre de le faire… On essaie de transformer
des petits scandaleux en subversifs, qui, finalement collent très
bien à leur époque. Ils sont rangés plutôt que dérangeants.
Demandez-leur plutôt à eux, on vient toujours me voir pour parler
d'eux, mais eux se gardent bien de parler de moi, ils se
comportent à mon égard comme les officiels qui soi-disant les
accusent de tous les maux. Quant à l’espace de liberté dont
vous parlez, mon exemple montre que cela est faux. Au moment
où l’un est accepté et devient une institution littéraire et l’autre
retrouve un éditeur pour son journal intime, moi c’est le
contraire: je n’ai plus d’éditeur, on me coupe les vivres et on
m’empêcherait de publier mon propre journal intime si je n'avais
pas eu la bonne idée prémonitoire de l'interrompre il y a
quelques années… Je suis donc obligé de rééditer mon
premier livre, épuisé depuis vingt ans, qui n’avait pas été lu par
toute une génération. Le seul critère du dérangement est la
mise sous silence, à toute époque. On vous refoule. La petite
médiatisation qui a eu lieu autour de mon livre n’est là que pour
éviter que je me plaigne d’être ostracisé. Une petite émission de
télé, une petite émission de radio, un petit article, c'est toujours
utile pour me discréditer quand je remarque qu’on ne parle pas
assez de mes livres pour qu'ils se vendent, et donc pour que je
puisse en écrire d'autres…
C’est une conspiration ?
Non, je l’ai déjà dit: je ne crois pas à l’existence d’un complot.
C'est plutôt une mode à l'envers: c'est dans l'air du temps de me
débrancher. Gogol se déplaçait toujours avec une valise remplie
des articles négatifs écrits sur lui. Cela lui permettait de lutter
contre la paranoïa et d’exorciser la douleur de traîner ça dans sa
tête tout le temps. C’était sa valise de merdes, sa poubelle avec
qui il sortait toujours. Il la mettait sous les tables et pouvait
penser à autre choses. C’était une manière de se dire qu’il ne
rêvait pas cette hostilité et en même temps de s’en libérer.
Y-a-t-il toujours une mainmise soixante-huitarde sur la
culture ?
Je crois avoir été le premier, déjà en 1985 à la dénoncer. Il fallait
dire non à cette fausse liberté, à cette fausse révolte, cette
fausse subversion qui était la trahison des idéaux libertaires
des années 60 par des bourgeois " de gauche " désireux de
remplacer ceux " de droite ".
La France est elle gavée d’Art et de littérature, au point d’en
être blasée et de la négliger ?
Non, le vrai problème est la carence d’Art. Il y a une ignorance
fondamentale de ce qu’est une oeuvre d’Art depuis une
soixantaine d’années. J’ai vécu dans l’Art depuis toujours et je
veux le défendre. A mon sens, même un militantisme de l’Art ne
serait pas suffisant. C’est crucial de lutter contre sa prétendue
mort inculquée comme une Loi depuis Marcel Duchamp.
Lui-même a d’ailleurs été mal compris : Duchamp n’était pas
contre l’Art, il était contre la « culturisation » de l’art, sa
récupération par les parasites cultureux. Il swinguait autant que
Duke Ellington, dont il était contemporain. La confusion qu’on
entretient entre la culture et l’Art, entre le beau et le joli, entre le
social et le révolutionnaire, tout cela fait qu’on n’a plus le sens
de ce qu’est une oeuvre.
Vous vous mettez en scène de façon très exhaustive dans
toute votre œuvre. Est ce pour atteindre l’ultime subjectivité ou
l’ultime objectivité ?
Je suis extrêmement objectif. Mon expérience personnelles des
artistes et celle que m’a rapporté mon père, de la bouche même
des génies du jazz qu'il a fréquentés à New York au milieu des
années 50, est que le grand art n'est qu'objectivité. Une seule
note à jouer dans telle ou telle circonstance. Miles Davis n’est
que le concrétisateur objectif d'une évidence qui se présente. Il y
a sur chaque événement une seule chose à dire, même si
certains ont peur de le faire. C’est pour cette raison que je me
sens souvent obligé de le faire puisque les autres ne s'y collent
pas. Ce n’est pas mon goût qui est en jeu. Je passe pour un
provocateur subjectif, alors que je suis un "dégageur de sens"
objectif.
Pour aller vers plus d’objectivité, la science est récemment
venue au secours du roman en France. Cette voie est elle la
bonne ?
Je ne crois pas. Moi je suis dans le présent et sa transfiguration.
C’est la définition parfaite de l’improvisation jazzistique. La
transfiguration implique la mystique de l’instant et
l’improvisation qui en découle, qui en dépend. C’est la joie de
mourir plutôt que la joie de vivre qui est présente chez la plupart
de mes collègues. Voilà pourquoi ils se réfugient dans un futur
qui est d'autant plus facile à imaginer qu’il n’arrivera pas. Ils se
tromperont et ils se trompent déjà. Je prends toujours l’exemple
de Robida [illustrateur de Jules Verne, ndlr] qui a imaginé des
vélos volants dans Paris à l'an 2000, mais pas des téléphones
portables !
Le suc de l’œuvre est donc la mystique et rien que la
mystique, pour vous.
Oui, même Marcel Duchamp, pour y revenir, était un mystique. Il
n’était pas un nihiliste mais un mystique du rien. Le ready-made
est une œuvre totalement mystique. On prend un objet et on le
sacre. On l'entoure d' une liturgie. Marcel a pris un
porte-bouteilles du BHV " au hasard" et en a fait un calice, un
tabernacle. Ceux qui suivent Duchamp en désacralisent au
contraire l’objet dénaturent sa subversion.
Houellebecq fait partie de ces grands « désacralisateurs ».
Dans votre préface, vous vous déclarez être à ses antipodes,
mais vous avez pourtant tellement de points communs…
Déjà topographiques, puisqu’on était voisins. Moi qui ai des
difficultés à gagner ma vie aujourd'hui, je crois que je vais finir
guide de cour d'immeuble ! Je vais me faire payer pour faire
visiter aux fans du Prix Interallié 2005 l’endroit où a vécu le grand
Michel !
Vous le revoyez ?
Non, mais on se parle à travers nos livres, celui-là en particulier,
Le Vingt-septième livre… C’est le seul écrivain à qui j’ai eu envie
de parler aujourd’hui sans avoir besoin de se téléphoner. Il est
intéressant de voir que l’époque a produit deux écrivains si
différents qui habitaient juste à côté. L’analyse n’avait jamais été
faite, je me suis permis de la faire.
Est-ce que vous allez continuer à écrire, est-ce que vous
avez encore envie ?
Ah oui ! Toute ma vie, j’aurais envie d’écrire. Ce n'est pas une
question d'envie, mais de possibilité éditoriale. Tant que je ne
retrouverai pas la liberté que j'avais de publier ce que j'ai à
écrire, je ne pourrais pas avancer. Il y a certaines choses qui ne
peuvent pas être dites clairement aujourd'hui, et moi je ne veux
pas accepter de les dire d'une façon plus obscure pour
m'adapter à l'édition française! Prenons comme signe que tout
ce que j'aurais à dire sur les manifestatins d'aujourd'hui, vous
même sur internet vous ne pouvez pas les mettre en ligne car
mon dégoût pour les jeunes anti- CPE et ma détestation des
vieux pro-CPE sont irrecevables. A peine si vous me laissez dire
que je suis du côté des casseurs qui sauvent l'honneur de ces
étudiants luttant pour plus de sécurité, en massacrant la
Sorbonne comme l'autre soir. Péguy aurait été fier d’eux. Je suis
obligé de remarquer que la violence qui s’exprime aujourd’hui
en France coïncide avec la réédition de mon premier livre. Au
régal des vermines devrait être dans la poche de tous les
casseurs !…
Laurent Simon
Marc-Edouard Nabe
Ed.
0 p / 0 €
ISBN:
 Inquiétant ? Certes. Mégalo ? Sûrement. Talentueux ? Pour sûr. Délirant ? Pas tant que ça. Première interview dans la Zone de cette rentrée 2009.
Inquiétant ? Certes. Mégalo ? Sûrement. Talentueux ? Pour sûr. Délirant ? Pas tant que ça. Première interview dans la Zone de cette rentrée 2009.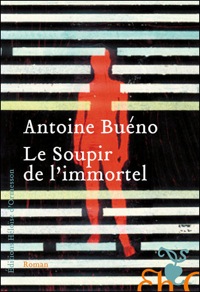 Le soupir de l’immortel
Le soupir de l’immortel
