Wally Lamb livre ses secrets
- font size decrease font size increase font size
 Au début du mois de janvier, alors que le gratin journalistico-littéraire goûtait aux joies du junket auprès de James Ellroy, un autre grand écrivain américain posait tranquillement ses valises à Paris. Wally Lamb, l’auteur du magnifique roman La Puissance des vaincus, a en effet profité de la sortie de son troisième opus pour passer quelques jours en France. Entremêlant les registres et les temps, Le Chagrin et la Grâce est un texte joyeusement désespéré où l’existence de Caelum se heurte à l’histoire des Etats-Unis. C’est au bar de l’Hôtel de l’Abbaye que nous avons eu le plaisir de retrouver Wally Lamb pour parler de ses romans, mais aussi des ateliers d’écriture qu’il anime dans une prison pour femmes du Connecticut, de sa vision de la jeunesse américaine et des secrets de famille trop bien gardés. Quand le romanesque retrouve ses lettres de noblesse. Rencontre.
Au début du mois de janvier, alors que le gratin journalistico-littéraire goûtait aux joies du junket auprès de James Ellroy, un autre grand écrivain américain posait tranquillement ses valises à Paris. Wally Lamb, l’auteur du magnifique roman La Puissance des vaincus, a en effet profité de la sortie de son troisième opus pour passer quelques jours en France. Entremêlant les registres et les temps, Le Chagrin et la Grâce est un texte joyeusement désespéré où l’existence de Caelum se heurte à l’histoire des Etats-Unis. C’est au bar de l’Hôtel de l’Abbaye que nous avons eu le plaisir de retrouver Wally Lamb pour parler de ses romans, mais aussi des ateliers d’écriture qu’il anime dans une prison pour femmes du Connecticut, de sa vision de la jeunesse américaine et des secrets de famille trop bien gardés. Quand le romanesque retrouve ses lettres de noblesse. Rencontre.
Vous n’étiez plus venu en France depuis près de dix ans. Quel rapport entretenez-vous avec ce pays ?
J’ai appris le français au lycée pendant quatre ans, mais au moment où j’étais enfin capable de penser dans cette langue, je suis entré à l’université où j’ai arrêté de l’étudier. Du coup, j’ai beaucoup perdu. En venant ici, je retrouve le plaisir de me familiariser avec elle. Bien entendu, je ne comprends pas tout, mais j’aime entendre le flot des conversations rapides et repérer quelques phrases dans les journaux. Je tiens d’ailleurs à remercier les éditions Belfond qui ont considéré que mes livres étaient suffisamment bons pour être publiés ici. Je suis ravi que des lecteurs français s’intéressent à mes histoires et aux questions assez américaines qu’elles traitent.
À l’instar de vos deux précédents romans, Le Chagrin et la Grâce est un texte riche et très ambitieux. Comment l’avez-vous abordé ?
Mes romans sont nés d’idées très différentes. Pour le premier, j’ai d’abord pensé à une ligne de dialogue dans la bouche d’un des personnages. Au départ, je croyais même que ça pouvait être une nouvelle. Le deuxième est né d’une image en mouvement : un homme qui conduit son pick-up et s’éloigne sur une route déserte. Quant à celui-ci, il est le fruit de ma réaction au massacre de Columbine. Au départ, je n’avais pas l’intention de faire un roman aussi complexe. D’ailleurs, je n’ai jamais de plan bien défini lorsque je commence à travailler. C’est comme si j’entrais dans une forêt très dense et que je pouvais seulement espérer en sortir vivant. Je passe beaucoup de temps à écrire mes livres. Quand je suis dans cette forêt, bien souvent je me perds et je crains de ne pas arriver à rassembler tous les fils qui composent mon histoire. Il faut absolument que je combatte ma peur pour continuer à écrire et comprendre ce que veux dire tout ça.
Justement, votre roman part d’un fait réel qui a traumatisé l’Amérique : le massacre de Columbine. Pourquoi avoir choisi de parler de ce drame ? Que représente-t-il à vos yeux ?
Vous connaissez la théorie des sept degrés de séparation ? J’avais une relation au quatrième degré avec l’auteur d’un massacre scolaire qui avait eu lieu quelques mois avant Columbine, dans un lycée du Kentucky. À l’époque, les deux filles de ma cousine étudiaient dans ce lycée. Leur meilleure amie était la sœur ainée du tireur. Le jour où son frère a commis cet acte irréparable, elles l’ont vu faire les cent pas dans les couloirs du lycée en pleurant et en répétant : « Je n’ai jamais eu aucun problème dans cette école, je n’ai jamais été absente, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée... ». Repenser à cette histoire me rendait extrêmement triste. Je me demandais sans cesse : comment cet épisode a-t-il affecté sa vie ? Qu’est-elle devenue ? Comment a-t-elle réussi à sortir d’une telle épreuve ? Puis survint le massacre de Columbine qui a été largement couvert par les médias. À l’époque j’étais enseignant en lycée depuis vingt-cinq ans et donc tout à fait capable de me projeter dans cette situation. Mes fils étaient adolescents, ce qui m’a rendu particulièrement sensible à l’événement. Au fur et à mesure que je m’y intéressais, toute cette histoire me révulsait et me faisait terriblement peur. Finalement j’ai compris que ce qui attire les écrivains, ce sont les choses sur lesquelles ils ont besoin d’écrire pour trouver un sens, peut-être même une solution.
Dans ce troisième roman, vous faites état d’une jeunesse américaine à la dérive où les différences sont mal perçues. Qu’en est-il vraiment ?
Pour moi, ce n’est pas mal d’être différent, mais je pense qu’il est très difficile de l’être dans le contexte du lycée. Lorsque j’enseignais, les étudiants qui s’orientaient vers mes cours d’écriture n’étaient pas dans le courant principal, ils ne faisaient pas partie des élèves populaires, ceux qui sont à la mode. Souvent, il s’agissait d’ados habillés tout en noir, avec des cheveux longs ou verts ou les deux… J’adorais ces étudiants-là. La plupart d’entre eux étaient issus de familles compliquées, souvent défavorisées et j’ai toujours senti un lien particulier avec ces élèves pour qui la vie n’a pas été facile.
Les secrets de famille, la question de l’héritage, celle de l’identité… on retrouve dans Le Chagrin et la Grâce des thèmes déjà présents dans vos précédents romans. Pourquoi ces sujets en particulier ?
C’est vrai que ce sont des thèmes récurrents. En vérité, ma propre famille portait un lourd secret : mon grand-père a essayé de tuer ma grand-mère en la poignardant. Elle a survécu à l’attaque et, lui, a été incarcéré dans un hôpital psychiatrique où il resté cinq ou six ans avant de mourir. Il est mort là-bas, tout seul, et c’est quelque chose que ma famille a caché par honte ou par traumatisme. Ma mère m’a toujours dit qu’il était mort avant ma naissance, mais c’était faux : il a disparu quand j’avais à peu près six ou sept ans et je ne l’ai appris qu’à l’âge de seize ans. L’idée que certaines familles conservent des secrets pour protéger les enfants d’une réalité un peu honteuse est un matériau que j’ai envie d’explorer. Lorsque j’ai commencé à travailler sur Le Chagrin et la Grâce, j’encadrais pour la première fois des cours d’écriture dans une prison pour femmes. Je les aidais à écrire ce qu’elles avaient besoin d’évacuer et au fur et à mesure que la confiance s’établissait, qu’elles commençaient à me connaître et à se connaitre entre elles, elles ont abordé leurs propres secrets de famille. C’était souvent terrible : des histoires d’inceste, de violence, de faim et de manques. Le fait de les coucher sur le papier leur permettait de s’alléger un peu de ce fardeau, de se libérer de ce qu’elles avaient gardé secret pendant si longtemps. En le partageant, ce poids devenait moins lourd à porter. De mon côté, je me suis toujours dit que pour écrire une nouvelle histoire, je devais revenir aux anciennes. Je pense toujours au même personnage : un homme qui vit dans le confort et l’équilibre, menant une existence étriquée, et qui choisit d’abandonner la sécurité du foyer pour se confronter au vaste monde, à la vraie vie, pour mener ses propres batailles et comprendre finalement que le but qu’il s’était fixé initialement n’était pas forcément celui dont il avait vraiment besoin. Je suis très intéressé par ces quêtes où l’on finit par trouver des choses qui nous sont étrangères et qui nous rendent heureux.
Comment parlez-vous de littérature aux prisonnières qui suivent vos ateliers d’écriture ?
J’utilise des sortes de « modèles ». Il y a une série baptisée « Pushcart prize » (« Le Caddie littéraire ») qui paraît tous les ans aux États-Unis et qui rassemble les meilleures œuvres courtes de poésie, de fiction et de non-fiction publiées dans les magazines littéraires de l’année précédente. J’ai eu la chance d’avoir une nouvelle publiée dans cette collection. Pour introduire mes étudiantes à la littérature, j’ai commandé un exemplaire de ce volume pour chacune d’entre elles et leur ai dit : « Lisez tel ou tel texte et choisissez celui qui vous plait et celui que vous désirez étudier ». Elles ont donc une partie de contrôle sur le texte qu’elles choisissent. Je me concentre davantage sur la littérature contemporaine plutôt que sur la littérature classique. Mes étudiantes sélectionnent des textes très variés : des écrits d’avant-garde, des choses plus conventionnelles, de la poésie…
Vos deux premiers romans se sont placés en tête de la liste des best-sellers du New York Times. Le Chagrin et la Grâce connaît également un vif succès. La recette du bon roman existerait-elle ?
C’est difficile de vous répondre, il n’y a pas vraiment de recette. Chacun de mes romans est très différent, pas forcément au niveau des thèmes, mais plus au niveau de la technique. J’ai à chaque fois l’impression d’être un débutant. Je pense qu’il ne faut pas commencer un texte en pensant à l’effet qu’il peut produire ni à la réaction qu’il suscitera. L’étape la plus décisive est sans doute la réécriture. Même si ce n’est pas un concept très français, je trouve important de s’inscrire dans une communauté d’écrivains, de partager et de faire des lectures de ce qu’on a déjà écrit. C’est en s’ouvrant aux critiques des autres que l’on devient meilleur. En plus des ateliers que j’anime en prison, je fais partie de deux groupes d’écrivains. Il y a des tas de choses que je n’aurais pas écrites de la même manière si j’avais été seul. Il y a dix ans, quand mon roman La Puissance des vaincus a paru en Europe, j’ai fait un petit peu de promotion sur le vieux continent. Chaque fois qu’était abordée la question des cours d’écriture, mes interlocuteurs devenaient assez critiques et émettaient des doutes en disant : « Soit on est un écrivain, soit on ne l’est pas. » Je suis resté poli, mais j’étais très loin d’être d’accord avec eux.
Avez-vous des rituels d’écriture ?
Plus tôt je commence à travailler, mieux c’est. Je mets généralement mon réveil à 5h30 pour aller dans une salle de musculation. Faire circuler le sang aide à la créativité. Quand je passe directement de mon lit à mon bureau, ça ne marche pas. En général, j’essaie de commencer à écrire vers 7h30 et je m’arrête vers 14h, car c’est le moment où mon esprit créatif s’éteint. J’aime entendre le bruit de l’eau qui coule quand je travaille. J’ai donc installé une petite fontaine murale dans mon bureau. Je l’entends à peine, mais cela me calme. J’écoute également beaucoup de musique. Pas trop de classique ni d’opéras, mais du contemporain, du rhythm and blues, du folk, du gospel, un petit peu de pop. La musique m’aide à écrire, pas seulement parce qu’elle me détend, mais aussi parce qu’il m’arrive d’entendre une phrase dans les paroles qui va me donner une idée et nourrir mon inspiration. Je suis assez superstitieux, je possède des figurines qui portent chance, des petites statuettes – des dieux et des déesses grecques. J’ai aussi une baleine d’albâtre et un bouddha dont je caresse la tête avant de travailler. En fait, j’ai des tas de petits rituels…
Pouvez-vous nous parler de vos projets ?
J’ai déjà le titre de mon prochain roman, même si je n’ai pas encore vraiment d’histoire. Ce sera We are water (Nous sommes l’eau). Lorsque j’étais petit, la ville où je suis née a connu une grande inondation. Une digue s’était brisée et d’énormes morceaux de glace avaient été emportés par le courant. Par ailleurs, mes deux fils vivent à la Nouvelle-Orléans. L’un d’entre eux y était lorsque l’ouragan Katrina a frappé la ville. Il s’agira donc d’une histoire d’eau, mais une eau qui n’est pas bienfaisante comme peut l’être celle de la fontaine de mon bureau ! Non, je voudrais parler de l’eau destructrice, l’eau des déluges. J’évoquerai bien évidemment le déluge biblique.
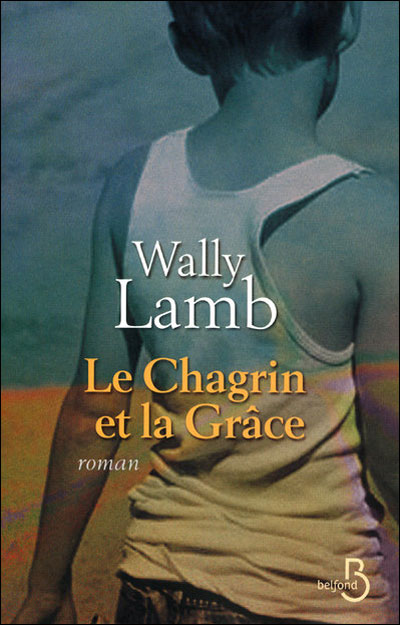 Le chagrin et la grâce
Le chagrin et la grâce
Wally Lamb
Ed. Belfond
23 euros - 532 p.